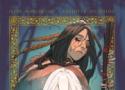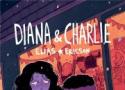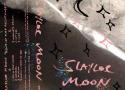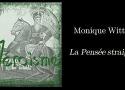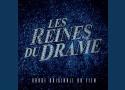Depuis plus de vingt ans, alléché par la taille du marché chinois, Hollywood s'est plié à la censure de l'Empire du Milieu. Finis les sujets sensibles comme le Tibet ou Taïwan, finis les personnages LGBTQIA+... : retour sur les compromissions de l'usine à rêves.
Le tournant date de 1997. Cette année-là, la sortie en salle de trois films – Sept ans au Tibet de Jean-Jacques Annaud, Kundun de Martin Scorsese et Red Corner de Jon Avnet – suscite la réprobation du gouvernement chinois. Pékin dénonce la mauvaise image de la Chine véhiculée par ces productions, place les studios concernés sur une liste noire et menace d'exclure de son gigantesque marché les films qui ne lui conviendraient pas. À Hollywood, le message est reçu cinq sur cinq… En quelques années, l'usine à rêve se met au pas de la censure chinoise : finis certains sujets sensibles tels que le Tibet, le Dalaï-Lama ou Taïwan ; finis les thrillers avec de méchants Chinois ; finis les personnages LGBTQIA+… Les scénarios sont caviardés, les scènes coupées, principalement dans les versions chinoises, comme pour Iron Man 3 (2013), mais aussi parfois dans la version originale, à l’instar de Looper (2012). L'usine à rêves ne fait pas que s'autocensurer : elle laisse aussi tomber l'une de ses plus grandes stars, Richard Gere, parce que son engagement pour les droits humains et pour un Tibet libre déplaisait à Pékin… En 2020, l’association Pen America, qui lutte pour défendre la liberté d’expression aux États-Unis, a publié un rapport très complet sur la manière dont la censure chinoise a influencé la réalisation et la distribution de plusieurs films américains. Son auteur, James Tagger, témoigne dans ce documentaire aux côtés de plusieurs acteurs de l'industrie du cinéma – le journaliste spécialisé Erich Schwartzel, le producteur Chris Fenton, le scénariste Jeremy Passmore…
Discover the power of the European Citizen’s Initiative (ECI), a unique participatory democracy tool that empowers EU citizens to shape Europe by proposing new legislation. Engage directly with EU policymakers by supporting or launching an initiative that matters to you. Learn how the ECI works, explore active initiatives, and utilize resources to make your voice heard in the European Union. Get involved today and help drive change across Europe with the European Citizen’s Initiative.
Searching for connection through abstract rhythms and isolated sonic realms, Slaylor Moon mediates on the theme of love in a way that is distinctly queer and absent-mindedly weird. Despite 10 years of performing and recording alone ‘Zone Of Pure Resistance’ is her first solo release, out on glitter cassette via Maple Death Records.
Scientist of the brain turned scientist of psychic soundscapes, Sydney Koke (Shearing Pinx/The Courtneys), Strasbourg via Vancouver artist, specialises in a form of queer, spooky, and dislocated electronic abstraction assembled from the disparate substrates of early 2000s experimental electronic music, old school rave, 70s industrial, no wave, and noise rock: a dorky cyborg symbiosis of polyhedral no-tempo MPC rhythms, flickering future tones of marine microorganism holographic glimmer, and intimately vague spacer-woman vocals delivered with cold intention, generating an ultraviolet personal microcosm of queer sexuality, formalist aesthetics, and multi-directional emotive imaginals – a volatile exploratory spectrum with a consistent sense of (developing) identity and curiosity.
credits
released August 17, 2019
Music: Sydney Koke
Mastering: Vymethoxy Redspiders
Avec le Collectif Insurrection Trans Représentantes : Camille, Nathaniel, Linda Invitée : Christine Rougemont, artiste et réalisatrice « Ce qu’il me semble important de relever, c’est que dans non-binaire, l’emphase, l’accent n’est pas tant mis sur le binaire que sur le non… » Emma Bigé, Paniques morales transphobes « Face au backlash anti-LGBTQ+, nous refusons […]